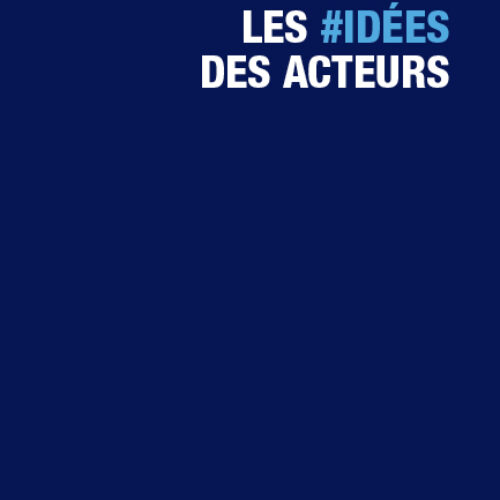Tribune

Par
Béatrix de Lambertye
Consultante Obésité-TCA
« Comme c’est dommage, tu as un si joli visage. »
L’injonction paradoxale au coeur de la problématique de l’obésité
Découlant du concept de « double contrainte » développé par l’école de psychologie américaine de Palo Alto, l’injonction paradoxale naît quand on ne peut pas obéir à une instruction sans y désobéir, autrement dit lorsque l’instruction comporte des éléments contradictoires. Par exemple : « Il est interdit de lire cette affiche » provoque de la confusion mentale, car pour savoir que la lecture de l’affiche est interdite, il faut précisément la lire… et contrevenir à l’instruction.
À la fin du XIXe siècle, le mathématicien belge Adolphe Quételet, père de l’IMC, a élaboré des théories eugénistes sur un lien potentiel entre le surpoids et l’intelligence, tandis que l’industrialisation démocratisait le miroir, et la mode féminine dévoilait le corps. Une apparence esthétique normée et contrôlée par la balance, modèle de beauté, symbole de richesse et de bonheur, est devenue un enjeu. Cette recherche s’est amplifiée depuis les années 1960 alors que le développement de la grande distribution transformait les achats alimentaires en un supplice de Tantale : une offre vertigineusement abondante dont les candidats à une image corporelle standard devaient détourner les yeux.
Les réseaux sociaux ont renforcé le paradoxe : faire défiler quelques minutes des publications sur son téléphone permet de mesurer les contradictions entre influenceurs : jeûner, manger bio, faire six repas par jour ou un seul, être végan, ou crudivoriste… Chacun affirme du haut de sa science autoproclamée que le chemin proposé est le seul valable pour atteindre le nirvana.
Alors quelle solution ? Lire des ouvrages de professionnels aperçus sur un plateau de télévision, parfois consulter et ressortir avec un régime à suivre ? Le suivre, puis craquer. Reprendre inéluctablement du poids, voire plus. Refaire un régime, et entrer dans le yo-yo délétère. Peu de gens savent qu’ils sont là dans une démarche paradoxale : car se mettre au régime fait grossir, c’est officiel depuis le rapport de l’Anses sur la dangerosité des régimes restrictifs en 2011.
Paradoxe encore : alors que notre corps est une merveilleuse mécanique qui sait parfaitement piloter nos goûts et notre faim, nous n’écoutons plus ses signaux et nous mangeons en suivant des injonctions de qualité, de quantité, d’horaire, d’éducation qui ne respectent pas nos besoins. Et l’alimentation, source de vie et de plaisir, devient cause d’angoisse. Avec parfois l’espoir terrible de développer un cancer pour enfin perdre du poids. Vouloir être frappé par la maladie pour mieux vivre, n’est-ce pas là contradictoire ?
Les campagnes publicitaires pour les produits alimentaires aggravent la situation. Ainsi, au bas d’une publicité pour du chocolat ou des chips, peut-on lire : « Évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. » Cela revient au concept de l’affiche qu’il est interdit de lire, mais en plus violent : « Ne mangez pas de ce délicieux chocolat ou ces chips que je vous propose, c’est mauvais pour ce que vous avez. »
Entre culte de l’apparence et abondance, notre société provoque des troubles alimentaires : anorexie, boulimie, ou hyperphagie boulimique, cette dernière entraînant des surcharges pondérales devenues exponentielles et des maladies métaboliques.
La pathologie chronique qu’est l’obésité est qualifiée d’épidémie mondiale, et les discours publics enfoncent le clou d’une responsabilité individuelle alors qu’on l’a vu, la société tout entière est factrice d’obésité. Les publicités pour les régimes et les poudres magiques perdurent alors qu’on en connaît le danger. Si on peut acheter en pharmacie des produits amaigrissants, perdre du poids serait alors une simple question de volonté, et non une maladie ?
L’obésité n’est pas prise en charge – le sera-t-elle un jour ? – comme une affection de longue durée malgré sa chronicité avérée et ses comorbidités graves, dont la stigmatisation n’est pas des moindres. Ces patients ont besoin notamment de beaucoup d’activité physique adaptée, mais doivent la financer alors qu’ils sont en situation de précarité du fait de la discrimination qu’ils subissent.
Le paradoxe est donc à tous les coins de rue. Y compris dans les relations sociales : nombreuses sont les personnes qui ont entendu cette remarque à première vue anodine : « Ma chérie, comme c’est dommage, tu as un si joli visage »… « Au bout du compte, qu’est-ce qui est dommage ? », se demandent-elles, « Que j’aie un joli visage ? » Quand la bonne âme ajoute « C’est pour ton bien que je dis ça », le doute n’est plus permis : puisqu’elles sont grosses, elles n’ont même pas le droit d’être jolies…
Il paraît donc essentiel que la société change son regard et abroge son double discours, afin de ne plus enfoncer la personne en surcharge pondérale dans son symptôme tout en lui reprochant sa faiblesse. Comme le dit Alexandre Jollien, philosophe suisse touché par un handicap moteur : « Une société qui exclut est une société malade. » En permettant aux personnes en situation d’obésité de sortir du paradoxe destructeur, c’est notre société tout entière que nous participons à mener vers la guérison.