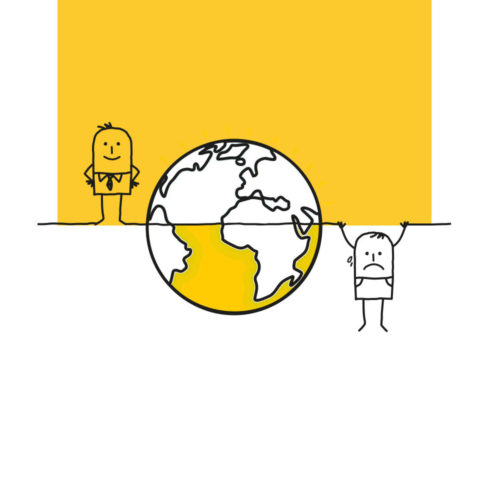INTERVIEW

THÉOPHILE SIMON
Journaliste indépendant
Afin d’observer les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur les populations touchées par l’extrême pauvreté, Théophile Simon, journaliste indépendant s’est rendu à Dubaï et au Kenya. Nous vous invitons suite à la lecture de cette interview à découvrir son reportage, disponible sur sa chaine YouTube.
Quel était le but de votre reportage au Kenya et à Dubai ?
Théophile Simon : J’ai voulu rendre compte de l’immense misère que la pandémie de COVID-19 a générée dans le monde. Il m’a semblé que nos sociétés développées, et moi le premier avec, n’avions pas saisi l’ampleur du phénomène. Il était d’autant plus important pour moi de faire ce travail qu’une bonne partie des mécanismes qui ont engendré cette misère sont la résultante de décisions prises dans le monde développé.
Depuis 30 ans, le nombre de personnes vivant dans une extrême pauvreté n’a fait que diminuer, aujourd’hui la tendance s’inverse. L’avez-vous perçu ? De quelle manière se traduit-elle ?
T.S. : Je l’ai bien perçu, oui. Les conséquences économiques de cette pandémie ont mis un coup d’arrêt spectaculaire à des millions de trajectoires de vie, dont la lente amélioration reposait sur des schémas bien établis mais très précaires ; c’est la vendeuse de légumes d’un bidonville kenyans, dont les modestes revenus s’accroissaient d’année en année avec l’augmentation de l’économie nationale, et qui pouvait envoyer ses enfants à l’école malgré tout. Le confinement a stoppé cette dynamique; les revenus chutent, la consommation baisse, et l’absence de solidarité nationale jette immédiatement la vendeuse dans une misère noire, et ses enfants avec. On retrouve le même mécanisme dans le Golfe, où des millions de travailleurs immigrés tenaient à bout de bras leurs familles restées au pays. Pour eux, c’est le retour forcé au pays et, pour les plus jeunes de sa famille, les rêves d’études qui s’effondrent. On ne peut s’empêcher de penser à l’effet papillon qu’aura cette pandémie; des millions de jeunes ont été stoppés net dans leur élan et leur développement. Cela aura des conséquences pour le reste de leurs vies.
Dans la plupart des pays pauvres comme le Kenya, 80 % de la population vit de l’économie informelle. Avez-vous identifié des solutions pour que cette population bénéficie efficacement d’un système de solidarité face à la crise ?
T.S. : L’une des choses qui m’a le plus frappé est que les habitants des bidonvilles ne semblent pas exister pour leur État. Non pas que ce dernier se désintéresse absolument d’eux, mais il n’a pas les moyens de le faire. Il n’y a ainsi pas de recensement ni d’identification des individus dans les bidonvilles. Les gens sont absolument seuls face aux difficultés de leurs vies. Comme vous l’avez mentionné, cela s’explique en partie par le fait qu’entre 80 % et 90 % des gens vivent de l’économie informelle, et n’ont donc aucun rapport avec l’administration fiscale. En temps de crise, il est donc impossible d’établir un lien direct entre l’État et ses citoyens. Le recensement complet de la population, l’attribution de numéro d’identification (sur le modèle du numéro de Sécurité sociale en France) est donc un préalable indispensable. Mais la nouveauté de ce début de siècle est la technologie mobile. Au Kenya, comme dans d’autres pays d’Afrique, les gens n’ont pas de compte bancaire mais utilisent le « mobile money », le portefeuille mobile. Que vous soyez riche ou pauvre, tout le monde a un téléphone et peut s’en servir pour recevoir ou envoyer de l’argent. L’État kenyan a tenté d’utiliser cette technologie pour envoyer une aide d’urgence aux plus pauvres, en allouant des sommes extrêmement variables et à l’aveugle à des centaines de milliers de numéros de téléphone. C’est une bonne solution si utilisée efficacement ; or cela ne semble pas avoir été le cas ici. La plupart des gens que j’ai rencontrés n’avaient soit rien reçu ou, pour les plus chanceux, reçu des sommes disparates qui n’avaient rien à voir avec ce que recevaient leurs voisins, pourtant dans des situations parfaitement similaires.
La crise épidémique et ses conséquences sur le long terme ont mis en lumière l’importance de l’éducation. Comment se traduit la difficulté d’accès des populations les plus précaires à un système éducatif de qualité ?
T.S. : L’accès à l’éducation est le nerf de la guerre. Souvenons-nous de cette citation de Nelson Mandela, qui trône d’ailleurs sur un panneau d’affichage à l’entrée du bidonville de Nairobi où je me suis rendu : « l’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde ». Avant la pandémie, l’éducation était déjà un combat pour les habitants des bidonvilles : même si l’État prend en charge l’immense majorité des frais de scolarité de l’école publique, il reste une fraction à la charge des parents, qui s’élève généralement à 5 euros par mois. Or, pour beaucoup de familles, notamment monoparentales, 5 euros, c’est le bout du monde ! Et lorsqu’il s’agit de manger ou d’aller à l’école, on choisit souvent de manger… Seulement pouvoir payer les 5 euros ne règle pas tout, car les enfants se retrouvent généralement dans des classes surchargées de 60, 70 voire 100 élèves. Le temps réel d’apprentissage, couplé à l’absence de moyens matériels, est alors infime. L’école publique des bidonvilles ressemble parfois à une illusion donnée aux plus pauvres, où les meilleurs apprendront à peine à lire et à écrire. La « véritable » école est alors l’école privée, beaucoup plus chère et hors de portée. C’est elle qui débloque les parcours et active l’ascenseur social.
Bien que les pays riches aient moins souffert de la crise que les pays pauvres, habiter dans un pays favorisé ne veut pas dire être immunisé contre le désastre économique. Vous montrez dans votre reportage des conséquences dramatiques, notamment pour les travailleurs immigrés. Quel est votre regard sur ce phénomène ?
T.S. : Je me suis rendu à Dubaï pour rendre compte de la situation tristement spectaculaire des pays immigrés du Golfe. Depuis des décennies, le Golfe se construit sur un contrat simple et froid : attirer des millions de travailleurs venus de pays pauvres, les payer davantage qu’ils ne le seraient dans leur pays d’origine, mais ne leur accorder aucun autre droit que celui de travailler. Plus de travail, plus de visa ! C’est ce qu’il s’est passé de façon massive lorsque l’économie mondiale s’est arrêtée, et le Golfe avec. Des millions de travailleurs ont du rentrer chez eux ou entrer en clandestinité pour s’accrocher à l’eldorado émirati. Beaucoup de ceux à qui j’ai parlé ne sont pas outrés que les choses se soient passées ainsi, car ils avaient intégré les règles dès le départ. Il faut par ailleurs comprendre les pays du Golfe : lorsque 90 % de votre population est étrangère, il est compréhensible de faire en sorte que celle-ci ne puisse pas s’ancrer dans le pays sans y contribuer économiquement, sous peine de quoi l’organisation de la société devient ingérable. Mais l’on ne peut pas s’empêcher de trouver anormal qu’aucun système de Protection sociale ne soit venu au secours de ces travailleurs immigrés pour leur permettre d’attendre la reprise. Ils ont le statut de marchandise et aucun compte n’est tenu de leurs aspirations individuelles. Résultat, des millions de familles de pays pauvres ont perdu leur principale source de revenu, détruisant autant de rêves d’ascension sociale.
La Covid-19 a brisé des trajectoires de vie à grande échelle, et ses conséquences ne font que commencer. Quelles leçons pour l’avenir en matière de réduction des inégalités économiques et sociales ?
T.S. : Il est évident que cette crise a révélé l’importance – le mot est faible – de la Protection sociale. Revenant d’un tel reportage, il devient clair que la principale clef de réduction des inégalités se trouve là. Mais si elle peut sembler être la formule magique, la Protection sociale est un luxe, elle coûte cher, et notamment en période de crise. C’est encore plus vrai pour les pays pauvres dont les émissions obligataires se renchérissent fortement lors de crises de cet ordre. Dans un monde aussi financiarisé et interconnecté, il serait bon d’améliorer les mécanismes d’entraide internationale afin d’éviter que les pays pauvres soient soumis à la double peine : une récession et une évaporation de leurs capacités d’emprunt. Or, une fois que vous avez emprunté à des taux raisonnables, encore faut-il pouvoir distribuer cet argent aux citoyens… La Protection sociale est donc conditionnée à la maîtrise de l’État de sa population et l’économie officieuse. C’est un chantier gigantesque sur lequel la communauté internationale doit encore travailler avant la prochaine crise. Il est néanmoins bon de rappeler que nous sommes sur le bon chemin : l’extrême pauvreté dans le monde recule inlassablement depuis 30 ans. La tendance devrait s’inverser quelques temps, mais la courbe reprendra la bonne direction à moyen terme. Puisse cette crise servir de leçon pour s’assurer que nous reprenions le chemin du progrès, de façon encore plus efficace.