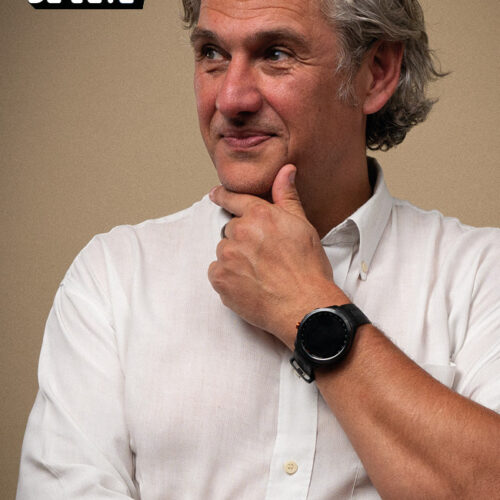Michel Monier
Ancien Directeur Général Adjoint de l’Unédic
Les efforts du CESE pour faire valoir son E terminal avaient été vains (voir « C’est chaud » Acte 1 de la série par Hervé Chapron). Le mal était bien plus profond que la promotion du E-environnemental ou d’un C-climatique ne pouvait guérir. Ce qui clochait c’était l’ADN même de ce Conseil Economique et Social.
Les deux, décidément, ne faisaient pas la paire. Un glissement progressif avait définitivement rendu incompatible le couple de l’économie et du social. Ce divorce était à torts partagés entre le « néo-libéralisme » et la « préférence pour la socialisation ».
Certains experts, de la sociologie et des mouvements sociaux, s’affichaient en rappelant à qui ne voulait plus l’entendre que « tout ça a commencé en 2019. Souvenez-vous : les Gilets jaunes ! Souvenez-vous ! ». Quelques clercs obscurs avaient une autre analyse.
Pour eux les « GJ » n’ont été que la partie visible d’un mal profond qui n’était pas seulement la défiance vis-à-vis des élites. Ce mouvement mettait au jour la nécessaire adaptation de notre modèle social. Il portait les prémices d’une renaissance des corporatismes.
Le déclencheur avait été la charte des travailleurs des plateformes. Après qu’ils eurent trouvé porte close auprès des confédérations syndicales qui n’avaient plus de représentatives que le nom, ils avaient obtenu cette charte qui garantissait des droits sociaux et, surtout, leur donnait un niveau de représentativité, limitée, mais qu’ils entendaient bien exercer.
Le mouvement s’était accéléré avec les employés de services domestiques. Ils avaient obtenu auprès des associations des familles une charte, eux aussi, qui leur donnait des droits que le syndicat de la profession leur refusait.
Les employés des EHPAD avaient fait de même et même mieux : ils avaient obtenu de leurs employeurs un droit de tirage en nombre de places pour, le moment venu, « passer de l’autre côté » : celui des résidents de ces établissements. Il en résultait une amélioration qualitative du service rendu.
Le mouvement était devenu majoritaire avec tous les employés peu qualifiés qui restaient indispensables pour assurer les services de base – sécurité, propreté, entretien – dans toutes les organisations où l’IA avait chassé les emplois que l’on disait intermédiaires.
La Protection sociale qui s’était transformée en solidarité universelle n’avait plus de raison d’être : chaque corporation organisait elle-même la fluidité des emplois et la protection de ceux qui les exerçaient.
Le CESE n’avait plus de raison d’être, le Conseil des Guildes du Travail, le CGT, était né. Cette institution, Conseil des Guildes du Travail, avait pour vocation de regrouper, sans ni les fédérer ni les confédérer, les guildes professionnelles (qui pour être reconnues comme telles devaient avoir obtenu une « charte des droits du travail et de l’emploi », autrement formulé il fallait pouvoir se prévaloir de droits corporatistes).
25 ans après l’année des GJ, le CGT s’était installé au Palais d’IENA. L’un des leaders éphémères avait prononcé cette phrase « ils ont défait l’ENA, réinventons l’IENA ! » ; la formule avait fait mouche.
Le CGT veillait sur les politiques de formation professionnelle : chacune des guildes définissant la sienne. Il en fut de même pour la maladie, les accidents du travail et les pensions de retraite. L’emploi régulé par des numérus clausus, le chômage était inexistant – sauf le cas de quelques individus qui, démissionnant d’une guilde, souhaitaient postuler auprès d’une autre.
La nécessité d’un dialogue entre les employeurs et les travailleurs s’était imposée naturellement. Le préalable avait été que les employeurs acceptent un changement radical : ils n’étaient plus employeurs, ils étaient devenus « demandeurs de travail ». Les travailleurs n’étaient plus des employés demandeurs d’emploi, ils se présentaient en tant que « fournisseurs de compétences » et ils étaient reconnus comme tels.
La robotisation, l’IA, avaient rendu le travail rare ; le rapport de force s’était renversé. Le modèle social avait explosé. Moins pour des raisons d’insoutenabilité budgétaire que par nécessité sociale : chacun voulait « ses droits » et les employeurs recherchaient des travailleurs !
Des caisses professionnelles prospéraient, elles assuraient les secours nécessaires et adaptés. Une révolution, sémantique, s’était faite : les « charges sociales » avaient disparu du discours, l’on reparlait de contributions sociales ! Les « fournisseurs de compétences » s’attachaient à les maintenir au niveau des attentes des « demandeurs de travail » qui eux s’employaient à les fidéliser. Certains d’entre eux, inspirés par un historien des mouvements patronaux d’antan, offraient même jusqu’au logement (on rapporte qu’un vieux grincheux aurait dit « tant qu’on y est, réinventons les corons ! »), le travail devenu rare était précieux. Les emplois que l’on disait « peu qualifiés » restaient indispensables, non robotisables et hors d’atteinte par l’IA. Ils étaient, de fait, bien rémunérés : le coût du travail n’avait plus de prix !
Les interventions de l’Etat se réduisaient à une portion congrue. Le Conseil des Guildes du Travail avait émis un vœu que l’Etat avait entendu et exhaussé : une loi favorisait grandement la philanthropie afin que ceux qui n’étaient dans aucune guilde reçoivent le bénéfice d’une aide. La solidarité n’était pas imposée, elle était encouragée par un habile dispositif non pas fiscal mais « dé-fiscal ».
Les représentants des guildes siégeant au CGT n’avaient d’autre rôle que d’observer les guildes se multiplier et d’enregistrer les diverses avancées que les chartes formalisaient. Ils avaient fait l’IENA, ils restaient proches des problèmes de terrain, le dialogue s’était installé, fructueux, entre les demandeurs de travail et les offreurs de compétences.
Une Protection sociale, diversifiée, adaptée, était née qui garantissait, à bas bruit, croissance, profit et répartition. L’Etat de ce fait se recentrait pertinemment sur ses missions régaliennes qui venaient capter une part redevenue raisonnable de la production nationale.
L’Etat cependant n’avait pas dit son dernier mot. Il le dit, fort habilement, par le moyen d’une révision constitutionnelle qui faisait du président du CGT le deuxième personnage de l’Etat. Or le CGT était gouverné par un collège… qui s’obligeât donc à désigner son président. Les débats furent à la hauteur de ceux que connut EElV ou bien de ceux, qui restaient d’actualité, à la commission européenne, mais un président fut élu.
Il proposa que le CGT se rebaptisa Conseil National de la Rénovation Sociale – CNRS. Le ver était dans le fruit : le CNRS se mit à fédérer les diverses chartes et à rechercher un tronc commun : « Il nous faut, sur la base des droits corporatistes, construire un droit commun, il faut dépasser les particularismes et imposer une sécurité sociale universelle ».
L’Etat répondait déjà : « S’il s’agit d’universalité il me revient de veiller à l’équité interprofessionnelle et à la soutenabilité du système »…