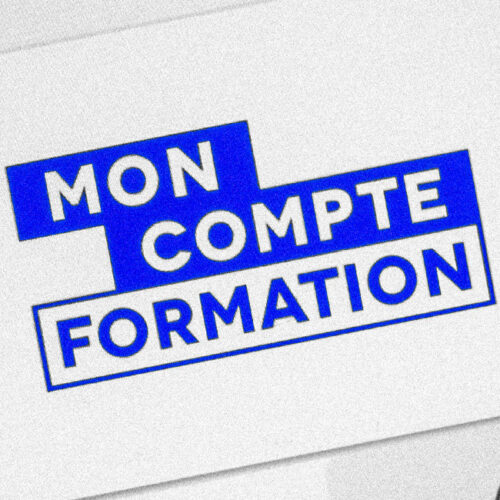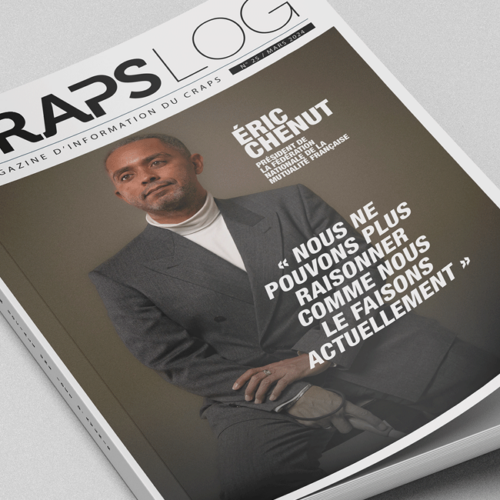Interview

Par
Astrid Panosyan-Bouvet,
Ministre du Travail et de l’Emploi
1. Le directeur général de France Travail dénonce régulièrement un certain « bashing » autour de l’institution. Rappelons que la création de Pôle emploi, en 2008, avait été qualifiée de plus grande réforme administrative depuis 1945 par le secrétaire d’État à l’Emploi de l’époque, Laurent Wauquiez. Quel bilan tirez-vous aujourd’hui de cet organisme public, dont l’objectif initial était l’atteinte du plein emploi ?
Les agents de France Travail que je rencontre sur le terrain sont des femmes et des hommes engagés avec le sens du service public chevillé au corps. Il faut du courage et de la conviction pour accompagner au quotidien des personnes dans le moment de vulnérabilité qu’est le chômage. J’aimerais voir les détracteurs passer une seule journée dans un de leurs bureaux.
Je veux d’abord regarder ce qui va mieux depuis plusieurs années : fin 2024, 8 demandeurs d’emploi et 9 entreprises sur 10 jugent positivement leur accompagnement par France Travail. Ce n’est pas anecdotique. France Travail n’est plus le simple guichet qu’il était il y a quelques années encore : c’est un acteur de terrain, qui innove, qui va au-devant des employeurs, qui tisse des partenariats locaux. C’est une organisation en mouvement, au service du plein emploi.
Cela étant dit, évidemment, comme ailleurs et comme toujours, il y a des marges de progrès. France Travail peut, et doit, aller chercher des gains d’efficacité, grâce à l’IA par exemple. Il faut aussi simplifier encore le parcours des usagers, poursuivre l’intégration avec les autres acteurs du réseau pour l’emploi et améliorer le lien avec les entreprises, surtout les TPE-PME, qui ne savent pas toujours comment mobiliser les services de France Travail, tout en accueillant mieux les nouveaux publics, comme les bénéficiaires du RSA notamment. La feuille de route est claire.
2. Ne serait-il pas opportun de territorialiser davantage les politiques de l’emploi afin d’adapter plus finement les dispositifs aux réalités et aux besoins spécifiques de chaque territoire ?
La territorialisation des politiques de l’emploi est une nécessité : les tissus économiques, les démographies et donc les réalités de l’emploi ne sont pas du tout les mêmes dans des régions proches du plein-emploi comme la Bretagne, dans celles où le taux de chômage avoisine les 9% comme les Hauts de France ou dans les Outre-mer où il dépasse parfois les 15%.
Territorialiser ne veut pas dire déléguer sans cadre. Ce cadre national cohérent est important pour maintenir une certaine uniformité dans l’accès aux droits et aux services pour tous les jeunes en formations et les actifs, quel que soit leur lieu de résidence.
Mais ce que nous faisons aujourd’hui, et qui s’inscrit dans les prérogatives régionales issues de la Loi Plein-emploi, c’est que l’Etat fixe le cap et le cadre puis que les acteurs territoriaux ajustent les dispositifs de formation et d’accompagnement vers l’emploi au plus près des besoins. Les compétences des collectivités territoriales, et notamment des régions et des départements, sont fondamentales en la matière et je me réjouis de la dynamique commune engagée grâce à la réforme de 2023.
Cette logique va en effet plus loin que la simple « territorialisation ». Il est aussi question d’« intégration » – avec l’instauration des comités départementaux et régionaux pour l’emploi qui rassemblent toutes les parties prenantes – et de « travail en réseau » – que l’on retrouve par exemple dans le réseau pour l’emploi autour de France Travail avec les missions locales, Cap emploi… Elle pourrait aller plus loin encore dans le cadre d’expérimentations avec des régions volontaires pour faire d’elles des chefs de file dans l’achat de formation pour les demandeurs d’emploi, par exemple, pour gagner en efficacité et en économie, en évitant les duplications avec l’Etat.
C’est un peu la même idée de faire confiance à ceux qui sont en première ligne que l’on retrouve d’ailleurs dans la réforme du financement de l’apprentissage que j’ai menée ces derniers mois. Les branches ont maintenant beaucoup plus de latitude pour réellement piloter la formation via la liberté de choix accrue qu’elles ont quant au niveau de prise en charge des formations en apprentissage.
Ce qui est en jeu dans tout ceci c’est à la fois une plus grande adéquation – j’assume parfaitement ce terme – entre compétences et besoins des entreprises et une plus grande réactivité face aux évolutions de ces besoins dans le temps.
3. La distorsion entre l’offre et la demande d’emploi reste un défi structurel. Le durcissement des règles d’indemnisation du chômage est l’une des récentes réponses apportées. Toutefois, de nombreux freins à la mobilité – comme le logement – relèvent de facteurs exogènes. Selon vous, l’offre de logement ne devrait-elle pas être davantage articulée avec celle d’emploi ? Et si oui, par quels leviers concrets ?
Je pense que ne parler que de logement est restrictif. Il faut prendre quelques pas de recul pour considérer la multiplicité et la diversité des freins à l’emploi. Il y a le logement bien sûr, mais aussi le transport, la garde d’enfant, la santé, la maitrise de la langue française, les situations d’illettrisme et d’illectronisme ou encore d’aidance familiale…
Les données sur le sujet sont parcellaires et fragmentées, mais selon France Travail, en 2022, 2,1 millions de demandeurs d’emploi étaient concernés par au moins un frein à l’emploi, soit 35% des inscrits à France Travail. 80% des bénéficiaires du RSA pour lesquels un diagnostic socio-professionnel a été fait ont été confrontés à des freins à l’emploi, et un tiers d’entre eux cumulent trois freins ou plus. 150 000 femmes sortent de manière durable du monde du travail chaque année faute de solutions de garde d’enfant.
Une première façon de s’attaquer au problème, c’est adapter le chemin vers l’emploi pour chacun de ceux qui en sont éloignés. Pour les bénéficiaires du RSA par exemple, l’accompagnement peut être professionnel – quand les freins sont vraiment de l’ordre des compétences, de la capacité à les mettre en avant… – mais il peut aussi être social ou socio-professionnel – quand, justement, ce sont les freins « périphériques » qui empêchent l’emploi. Nous sommes sortis, et c’est une bonne chose, d’une logique de « taille unique » qui devrait convenir à chacun sans vraiment convenir à personne. L’important quand c’est possible est de s’attaquer aux freins à l’emploi en même temps que la mise en formation ou en emploi car c’est dans cette dynamique là que les freins se lèvent le plus facilement.
Une seconde façon de s’attaquer au problème c’est de traiter les freins un par un pour tout le monde : accélérer sur la mobilisation de France Travail et des entreprises pour adapter la recherche d’emploi et le travail aux besoins des aidants, refondre le dispositif des crèches à vocation d’insertion professionnelle pour la garde d’enfant, faire davantage connaître et favoriser le recours aux outils développés par l’ANLCI pour lutter contre l’illettrisme… Il faut travailler sur ce sujet avec une boussole : être sélectif dans les combats et faire en priorité ce qui aura un impact rapide pour les bénéficiaires.
Malgré de nombreuses réformes en matière de formation professionnelle et d’apprentissage, la persistance des déséquilibres sur le marché du travail interroge. Les résultats restent en deçà des attentes, malgré des budgets conséquents. À quoi l’attribuez-vous ? Et quelles pistes d’amélioration privilégiez-vous aujourd’hui ?
Dans sa dernière évaluation des compétences des adultes en 2023, l’OCDE montre que les compétences des 16-65 ans dans les domaines clés en matière de traitement de l’information (littératie, numératie, résolution de problème) – c’est-à-dire globalement des compétences professionnelles de base – ont stagné en 10 ans ; les résultats de la France se sont, eux, dégradés et sont inférieurs à la moyenne de l’OCDE dans tous les domaines. C’est pour partie une question d’éducation initiale.
Ensuite, plus d’un employeur sur deux qui ne trouve pas rapidement de profil via France Travail affirme que c’est une question d’expérience et de diplôme. Et nous avons un stock relativement stable de trimestre en trimestre de plus de 450 000 emplois non pourvus et de plus de 2 millions de demandeurs d’emploi, dont certains de longue durée.
Cela nous dit deux choses. D’une part nous pouvons faire mieux en termes d’adéquation entre les compétences développées par la formation professionnelle continue et les besoins réels de l’économie. C’est le sens, je le disais, de la réforme du financement de l’apprentissage ou de la territorialisation des politiques formation-emploi. C’est aussi le sens de l’ouverture du CPF aux dotations complémentaires que j’ai lancée à l’automne dernier : ce que les travailleurs financent avec leurs CPF peut être complété par un financement d’entreprise, de branche ou de collectivité territoriale quand cela répond précisément aux besoins de l’économie – un abondement gagnant-gagnant en somme, avec aussi la neutralisation du ticket modérateur. C’est enfin l’objet de l’augmentation des formations avant embauche que France Travail finance avec son budget et une part du plan d’investissement dans les compétences. L’accès des entreprises a été simplifié et je demande à France Travail d’aller plus loin encore, pour les TPE-PME notamment.
D’autre part, cela montre à quel point nous sommes, à l’inverse du monde anglo-saxon, encore culturellement très – trop ! – ancré sur le diplôme obtenu par une formation longue et la compétence certifiée par un cursus académique plutôt que par l’expérience. Pour lutter contre ça, avec Catherine Vautrin et Elisabeth Borne, nous sommes en train de refondre France VAE ; cela permettra de vraiment donner de la valeur à l’expérience, tout en respectant le rôle encore central de signal qu’est la certification pour les employeurs. De même, lors de toutes mes interventions, j’incite les acteurs de l’emploi – ceux de l’IAE par exemple – à vraiment se rapprocher des entreprises ; ce sont deux mondes qui sont censés se parler, se faire confiance, travailler l’un pour l’autre, et ça n’est pas encore le cas. Enfin, je pense qu’il faut que les acteurs de la formation aillent beaucoup plus sur des modèles de formations théoriques courtes sur les compétences de base avec une mise en situation entreprises juste après pour apprendre le reste des compétences. Ceux qui le font ont des taux d’insertion de plus de 80%. Je suis persuadée que les opportunités pédagogiques de l’IA pour la formation vont transformer très fortement la séparation actuelle entre temps de formation continue et temps en situation concrète. C’est le sens aussi de la négociation que j’ai proposée avec Catherine Vautrin aux partenaires sociaux sur la simplification des dispositifs de reconversion, en mettant l’alternance au cœur de la démarche.
5. L’ubérisation de l’économie, tout comme l’émergence de l’intelligence artificielle, ne se contentent pas de transformer le monde du travail : elles l’impactent en profondeur. Face à la destruction annoncée de certains emplois, à la pénurie de compétences techniques comme les ingénieurs, quelles réponses faut-il dès aujourd’hui anticiper ? Formation, éducation, indemnisation : quelles sont, selon vous, les priorités ? Quelles opportunités et quels obstacles identifiez-vous ? Dans quels délais envisagez-vous de les mettre en œuvre ?
L’« uberisation » et la transformation du monde du travail par l’IA sont deux sujets bien différents. Sur l’émergence du travail indépendant qui contourne les structures traditionnelles de l’entreprise, des syndicats, des normes parfois, l’impératif pour moi est de continuer de chercher un équilibre entre deux choses également importantes. D’une part la liberté d’entreprendre : ce modèle convient bien à beaucoup de travailleurs pour des raisons qui leur sont propres et il est parfaitement respectable quand il est choisi. D’autre part la protection sociale : pour que le travail, quel qu’il soit, continue de participer à la prospérité collective et de garder son rôle assurantiel pour l’individu.
Pour l’IA, l’enjeu principal à mon sens est celui de l’adoption par les entreprises de manière systématique, structurée, fiable et éthique. Or la France n’a historiquement pas été la pointe de l’adoption de la robotique et du numérique. Résultats : des gains de productivité assez faible ces dernières décennies. Aujourd’hui, du fait de la structure de notre économie et de cette relativement faible propension à adopter le technologie, l’OCDE nous prédit des gains de productivité parmi les plus faibles du G7, 2 à 5 fois moins importants que les Etats-Unis en tête de classement. Une récente étude menée par Adecco montre à quel point les patrons sont assez peu engagés dans cette dynamique d’intégration de l’IA : faible appétence à la comprendre et l’intégrer dans leurs processus business cœur, préférence pour le recrutement d’experts externes plutôt que développement des compétences en interne. 30 à 40% des entreprises françaises utilisent ou créent des IA aujourd’hui. C’est un taux d’adoption faible par rapport aux 60% d’Amérique du Nord. 53% des actifs disent recourir à l’IA au travail mais dans un cadre généralement peu structuré (« shadow AI », IA « honteuse »). Il faut donc avoir l’humilité de se dire que nous ne partons clairement pas en pole position.
Du côté de l’offre, les acteurs de la tech, en particulier français si nous voulons des solutions souveraines, doivent donc continuent de développer les produits dont les entreprises ont besoin. Du côté de la demande – qui est principalement là où mon ministère peut intervenir – nous travaillons à mettre en place des fondations solides sur les référentiels de compétences et former toutes les catégories d’actifs : apprentis, demandeurs d’emploi, managers et dirigeants d’entreprises. Le train de l’IA ne passera pas deux fois. C’est le moment de monter dedans pour ensuite, au fur et à mesure des impacts observé sur le travail et sur l’emploi, ajuster nos politiques et nos pratiques.
6. Les déficits publics, y compris ceux des comptes sociaux, appellent une réflexion sur le financement de notre système de protection sociale. La « TVA sociale » revient dans le débat public. Pensez-vous que cet outil, en allégeant le coût du travail, pourrait indirectement – même en l’absence de croissance forte – favoriser la compétitivité des entreprises, créer de l’emploi et contribuer à réduire le chômage ?
En France, le financement de la protection sociale pèse de manière lourde sur le travail – 65% des recettes en proviennent – alors que ce financement est aussi fléché vers des risques dits « universels » (santé, dépendance, famille) qui ne concernent pas que les travailleurs. Le résultat est un écart important entre le coût employeur super-brut et le net dans la poche du travailleur. Cela affecte à la fois le coût du travail pour l’entreprise et le pouvoir d’achat pour le salarié.
Cela étant dit, il y a trois questions indépendantes auxquelles nous devons collectivement répondre et qu’il ne faut pas mélanger. La première est celle du montant de la protection sociale : où est l’équilibre entre solidarité nationale et responsabilité individuelle, dépensons-nous ce que nous devons dépenser ou pouvons-nous faire des économies et comment ? Ensuite, que voulons-nous faire assurer par le travail ? Cela nous permettra de déterminer si les cotisations peuvent être diminuées, lesquelles et de combien. Enfin, comment financer ce qui ne serait plus financé par le travail ?
La réalité est que la TVA sociale – la consommation donc – est seulement un outil parmi d’autres ; des sources de financement alternatives sont nombreuses : capital, héritage, rente, foncier, immobilier… Chacune de ces options a des avantages et des inconvénients sociaux, économiques, politiques, ainsi que des gagnants et des perdants.
Je ne me prononcerai pas à ce stade sur une préférence pour tel ou tel mécanisme. Nous allons fêter les 80 ans de la sécurité sociale en octobre prochain. La direction que nous voulons, comme nation, faire prendre à notre protection sociale nécessite une discussion approfondie, sérieuse, apaisée entre politiques, économistes et partenaires sociaux et c’est pour cela que nous sommes en train de travailler à une conférence sociale sur le sujet.
7. Le faible taux d’emploi des seniors devient préoccupant, alors qu’il y a vingt-cinq ans, les préretraites étaient fréquentes. Dans un contexte de croissance molle et de réindustrialisation difficile, est-il réaliste d’opérer le revirement nécessaire ? Quels leviers pourraient améliorer l’employabilité des seniors ?
C’est à la fois réaliste et impératif. Une croissance dynamique n’est pas un prérequis pour l’emploi des travailleurs expérimentés, c’est pour partie une conséquence positive de celui-ci.
Je veux rappeler que le taux d’emploi en France n’a jamais été aussi élevé et que c’est aussi le cas pour le taux d’emploi des seniors. Ce dernier a augmenté de plus de 3 points en 2024 pour les 60-64 ans. Il faut le dire, c’est grâce notamment à la réforme des retraites. Mais il est vrai qu’il reste beaucoup plus faible que certains de nos voisins européens.
C’est un gâchis monumental : humain avec des fins de carrière angoissantes et économique car nous nous privons de savoir-faire et de forces productives et contributives.
L’enjeu est double : relancer une dynamique de recrutement pour les salariés expérimentés et favoriser le maintien en emploi. Pour y répondre, je viens de lancer une grande initiative avec trois ambitions claires : changer la loi, changer les regards et changer les pratiques.
Changer la loi, c’est ce que le Parlement fait en ce moment. J’y ai présenté fin mai un texte qui transpose l’accord national interprofessionnel des partenaires sociaux de novembre dernier. Il prévoit par exemple la mise en place du contrat de valorisation de l’expérience pour les demandeurs d’emploi de plus de 60 ans qui donne une plus grande lisibilité à l’employeur sur le départ de l’employé à la retraite et lève ainsi un frein au recrutement, le décalage de l’ouverture de la retraite progressive de 62 à 60 ans pour faciliter le glissement progressif vers la retraite, ou encore le renforcement de l’entretien de mi-carrière pour envisager plus systématiquement les ajustements à faire pour permettre une fin de carrière sereine.
Changer les regards, c’est ce que nous faisons avec la grande campagne de communication que je viens de lancer. Il s’agit de déconstruire les stéréotypes liés à l’âge – l’âge qui est le premier facteur de discrimination dans le monde du travail. Il faut sortir de l’idée ravageuse qui date des pré-retraites de Raymond Barre que passé 50 ans, on a n’a plus tout à fait sa place en entreprise, et au contraire favoriser la prise de conscience qu’un travailleur expérimenté, c’est avant tout de la fiabilité, de l’expérience, une meilleure gestion du stress, un « toucher de balle » qu’on n’a pas nécessairement à 20 ou 30 ans, déjà 20 ans d’expérience du numérique… Bref, que l’expérience a de la valeur.
Changer les pratiques, enfin, c’est ce que nous faisons avec la publication d’un guide pratique pour les employeurs sur le recrutement et le maintien en emploi, un site internet pour ces mêmes employeurs et pour les salariés expérimentés plein de conseils pratiques et d’outils. Et c’est ce que nous incarnons avec des évènements dans toutes la France tout au long du mois de juin et juillet.
C’est la première fois que l’on met autour de la table les partenaires sociaux, les entreprises, les services déconcentrés, France Travail, l’APEC, des collectifs comme l’Association nationale des DRH ou Les Entreprises s’Engagent. Et ce n’est que le début. Nous n’avons plus le temps d’attendre !
8. La liste actualisée des métiers en tension a été publiée en mai afin d’aider les recruteurs dans les différents bassins d’emploi. Quels sont, selon vous, les principaux enjeux liés à cette liste ? Et quels autres leviers les pouvoirs publics pourraient-ils activer pour pallier la pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs clés comme le médico-social, le BTP ou encore l’hôtellerie-restauration ?
La liste actualisée des métiers en tension publiée en mai a une finalité : elle permet, sous réserve d’autres éléments d’appréciation à la main des préfectures, la régularisation des travailleurs étrangers en situation irrégulière exerçant un métier qui y figure.
Elle n’a aucune vocation à être la réponse principale aux tensions de recrutement observée dans certains métiers – le BTP, le médico-social ou l’hôtellerie-restauration pour ne citer qu’eux.
En particulier, elle n’exonère pas l’Etat de travailler sur l’accès à l’emploi des étrangers établis légalement en France. Les mois qui suivent l’arrivée légale d’un étranger en situation de chômage sont déterminants dans son parcours d’intégration, y compris professionnelle. Le taux de chômage des étrangers en situation régulière est 4 points supérieur à celui de l’ensemble de la population et il est tiré à la hausse par le chômage des femmes immigrées. C’est en partie parce que leur accompagnement immédiat vers l’emploi est insuffisant. Une meilleure prise en charge des primo-arrivants est donc nécessaire. C’est le sens de la circulaire que nous allons signer avec Bruno Retailleau et qui prévoit une prise en charge directement par France Travail les étrangers signataires d’un Contrat d’Intégration républicaine (CIR) qui ont déjà un niveau de français proche du niveau A2, ce pour la poursuite de l’apprentissage de la langue et l’insertion dans l’emploi. Plus largement, que ce soit pour les immigrés ou non, la réponse aux tensions de recrutement doit aussi comprendre la levée des freins à l’embauche – garde d’enfant, mobilité, illettrisme… – dont nous avons parlé.
Pour tous, il faut également continuer d’aligner la formation initiale – à la fois son contenu et le dimensionnement des filières, y compris professionnelle – avec les besoins de l’économie. Pour les trois métiers les plus en tension dans l’industrie – chaudronnier, soudeur et technicien de maintenant – la capacité de formation n’excède pas 50% des besoins de recrutement.
Enfin, sur les quelques 450 000 emplois non pourvus, les deux tiers sont des métiers pénibles et souvent mal rémunérés. Cette liste des métiers en tension n’exonère pas non plus les branches et les entreprises de travailler sur l’attractivité des métiers pour tous les travailleurs : reconnaissance financière, conditions de travail… Pour un autre tiers, il faut lutter contre les stéréotypes, en particulier auprès des adolescents, des étudiants et de leurs familles : chaudronnier dans l’industrie aujourd’hui, ça ne veut pas dire être un ouvrier de Germinal mais participer à façonner des pales d’éoliennes !
9. Quel premier bilan tirez-vous de la réforme du RSA, mise en œuvre depuis le 1er janvier 2025 ? Quel rôle France Travail doit-il jouer dans les mois à venir pour renforcer l’accompagnement et favoriser l’insertion des publics les plus fragilisés ?
La loi plein emploi de 2023 vise à rapprocher du travail les personnes qui en sont éloignées. Elle prévoit notamment une inscription automatique des bénéficiaires du RSA à France Travail à compter du 1er janvier 2025 et un accompagnement personnalisé qui met en jeu à la fois France Travail sur le volet professionnel et des conseils départementaux sur le volet social. L’idée, à laquelle je souscris pleinement est qu’on ne peut pas, en tant que société, s’exonérer de cet accompagnement vers l’emploi par un simple chèque.
En pratique, cette réforme du RSA ne date pas de janvier dernier. Une cinquantaine de départements ont expérimenté l’accompagnement social, professionnel ou socio-professionnel intensif des bénéficiaires du RSA depuis 2 ans. Les résultats sont intéressants : 12 mois après l’entrée en accompagnement, la moitié des personnes ont été au moins une fois en emploi et près d’un tiers y sont toujours.
Ce qui s’est produit en janvier, c’est la généralisation de ce nouveau mode d’accompagnement à tout le territoire. Et début juin, un décret a instauré le barème de sanctions pour les manquements aux engagements pris dans le cadre du rapprochement vers l’emploi. Au passage, pour tordre le cou aux récits erronés, les sanctions existaient déjà pour les bénéficiaires du RSA et les demandeurs d’emploi ; ce décret les rend plus proportionnées, graduelles, non-automatiques et réversibles, et repose sur le principe du « faisceau d’indices » plutôt que sur des radiations quasi-automatiques en cas de manquement comme c’était le cas jusqu’à présent.
France Travail, comme les départements, les missions locales et les Cap emploi ont un rôle clé à jouer dans les mois et les années à venir pour continuer à faire vivre ces nouvelles modalités d’accompagnement et à innover dans les méthodes d’insertion professionnelle en répondant aux besoins des bénéficiaires et des entreprises – en particulier avec des mécanismes de mise en situation professionnelle ou des formations pour renforcer l’employabilité moins classiques que la simple sélection d’offre d’emploi.
10. En quoi les partenariats entre France Travail et des acteurs majeurs de l’emploi, comme les entreprises de travail temporaire, peuvent-ils contribuer à réduire les tensions sur le marché du travail, notamment pour les métiers en forte pénurie ? Peuvent-ils également jouer un rôle dans l’accompagnement vers un emploi durable pour les publics les plus éloignés du marché du travail ?
Les entreprises de travail temporaire ont l’image d’un service assez monolithique de placement de travailleurs précaires pour des missions courtes. La réalité est bien plus nuancée.
Cette activité existe toujours. Mais si une partie des intérimaires cherche toujours la stabilité, elle correspond aussi de plus en plus à une demande d’ultra-flexibilité de la part de certains travailleurs – les slasheurs –, souvent dans des métiers en tension relativement techniques qui leur offrent des salaires bonifiés et la certitude de trouver des missions quand ils le souhaitent. Elles ont aussi développé d’autres activités, comme ce qui s’apparents à du portage salarial via des « CDI intérimaire », des services de chasse de tête pour du management intermédiaire ou de la formation professionnelle pour développer l’employabilité.
Dans ce cadre-là, ces entreprises ont une place tout à fait essentielle auprès des publics éloignés de l’emploi, très complémentaire de celles des autres acteurs publics. Elles peuvent offrir, pour des personnes fragiles, une première opportunité d’accès au marché du travail. Par leurs formations, en particulier à la sécurité dans les métiers à forte sinistralité comme ceux du BTP, elles ont aussi un rôle à jouer pour améliorer la qualité de l’emploi.