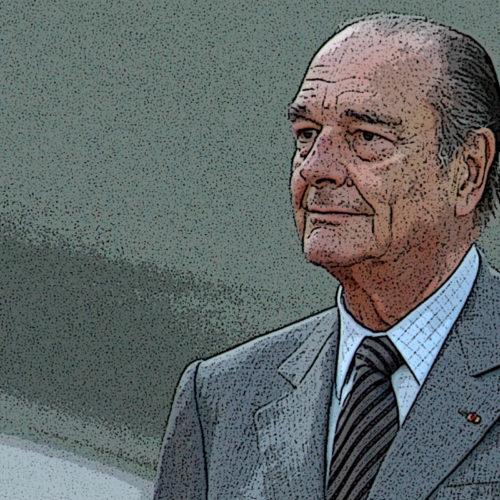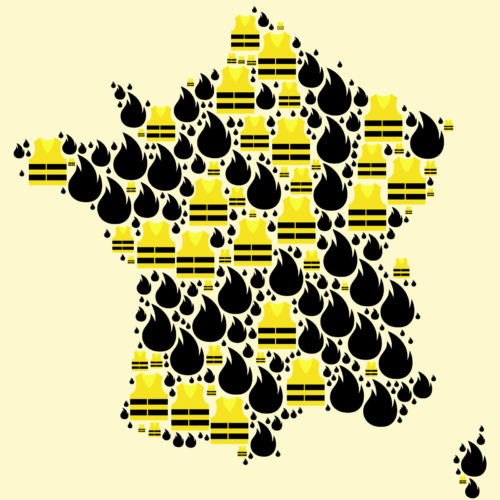INTERVIEW

Denis Gautier-Sauvagnac
Ancien Président de l’UIMM
Vous avez été Président de l’Unédic de 1994 à 2008. À ce titre, vous avez dû au sein de vos différents mandats prendre des décisions lourdes de conséquences, voire historiques comme la dégressivité des allocations ou gérer l’affaire des recalculés. Aujourd’hui, c’est une nouvelle Assurance-chômage qui est appelée des vœux du ministre. Que vous inspire cette volonté d’universalité (extension aux démissionnaires et aux indépendants) ?
La mise en place de la dégressivité a été décidée en 1992 avant que je devienne, selon les années, Président ou Vice-Président de l’Unédic (1994-2008) et je n’ai pas participé à la négociation qui a conduit à sa suppression en 2001. En revanche, j’ai bien été concerné, entre autres, par l’affaire des « recalculés », la restructuration de l’Unédic, et le système des intermittents du spectacle. L’intérêt de ces différentes questions est qu’elles démontrent la capacité des partenaires sociaux gestionnaires à prendre des mesures courageuses dans un cadre paritaire.
La restructuration de l’Unédic
Les partenaires sociaux, gestionnaires de l’Unédic, ne sont jamais restés les bras ballants devant les difficultés du régime, notamment pour rechercher des économies, y compris des économies de structure.
Si, pour réduire le nombre des Assédic de l’époque, la partie syndicale était moins allante que la partie patronale, c’est bien un accord entre des partenaires sociaux responsables qui a finalement permis, en 2001, de ramener le nombre des Assédic de 52 à 30 structures avec les économies de siège qui en découlaient.
Les « recalculés »
L’affaire des « recalculés » est née également d’une décision courageuse des partenaires sociaux, soucieux de réduire un déficit de l’Unédic qui allait croissant : en 2001, la durée maximale d’indemnisation a été réduite de 30 à 23 mois (ce qui restait, de fait, la période d’indemnisation la plus longue dans l’Union européenne), avec application aux chômeurs en cours d’indemnisation, dans le seul cas où la durée d’indemnisation restant à courir leur donnait suffisamment de temps pour s’adapter. Cette décision était parfaitement légale : l’indemnisation des demandeurs d’emploi ne résulte pas d’un contrat entre le demandeur et l’Unédic, mais de l’application d’un règlement qui, comme une loi, peut-être modifié en cours de route. Cela avait déjà été le cas, sans incident, quelques années auparavant.
Il s’est trouvé, à Marseille, un tribunal, saisi par des «recalculés », pour condamner l’Unédic à revenir sur sa décision. Ce jugement de première instance a été réformé plus tard par la cour d’appel de Paris, statuant, elle, en droit. Mais, dans l’intervalle, il a créé une certaine panique des pouvoirs publics qui ont tordu le bras des partenaires sociaux pour qu’ils abandonnent cette mesure d’économie. Exemple de l’inconstance de l’État, alors même qu’une décision courageuse avait été prise par les gestionnaires de l’Unédic.
Les intermittents du spectacle
Le système d’indemnisation des intermittents du spectacle, unique au monde, soulevait au moins deux questions majeures qui, ici encore, pesaient sur les finances de l’Unédic.
D’abord, le fait que beaucoup d’hommes politiques de tous bords considéraient que le système faisait partie de la politique culturelle de la France, tout en trouvant très commode qu’il soit financé par les seuls salariés du privé et leurs employeurs ; les parlementaires, les fonctionnaires, les professions libérales, les commerçants, etc. ne cotisent pas, à la différence de l’ouvrier maçon et son patron ou de la caissière de supermarché et son employeur, qui ne sont pourtant pas nécessairement les plus assidus aux spectacles des intermittents. Le coût du système, pour 100000 personnes, s’élevait à 1 milliard d’euros en 2002, soit le tiers du déficit de l’Unédic, qui indemnisait par ailleurs 2,1 millions de demandeurs d’emploi.
En outre, le système permettait qu’un intermittent du spectacle ayant travaillé 3 mois dans les 12 derniers mois soit indemnisé pendant les 9 autres mois de l’année, et ceci pendant 20 ou 30 ans, avec une allocation de chômage supérieure en moyenne à celle qu’obtient le chômeur de base, compte tenu de ce que gagne l’intermittent pendant ces 3 mois de travail dans l’année.
Toujours courageusement, les partenaires sociaux ont ramené la période de référence d’un an à dix mois, ce qui cassait la mécanique de reproduction indéfinie du système et qui a permis de maintenir pendant plusieurs années les effectifs d’intermittents autour de 100 000 personnes, alors qu’ils avaient doublé entre 1992 et 2002 sans que le nombre d’heures de travail augmente pour autant !
Au départ, en dépit d’une grande agitation (suppression de nombreux festivals, dont celui d’Avignon), l’État n’est pas intervenu. Mais, sous le précédent quinquennat, une loi a obligé l’Unédic à restaurer l’ancien système, toujours aux frais des seuls salariés du privé et de leurs employeurs.
Ces exemples nous montrent que, si l’État apporte sa garantie aux emprunts du régime d’Assurance-chômage, est en droit de se faire entendre des partenaires sociaux, il outrepasse ce droit quand il revient, pour des raisons politiques sur des décisions courageuses des gestionnaires, mettant en cause du même coup, le principe même de la gestion paritaire, beaucoup plus raisonnable qu’on ne le dit, et en tout cas moins dispendieuse que celle de l’État. C’est dans le même état d’esprit que le gouvernement demande aujourd’hui à l’Unédic de financer de nouvelles indemnisations (démissionnaires, professions indépendantes…) sans se préoccuper du financement de ces nouvelles dépenses qui appelleront nécessairement des augmentations de cotisation, accroissant d’autant le coût du travail, avec un impact sur l’emploi. C’est, en outre, un non-sens d’étendre aux indépendants un régime bâti pour les salariés, et de multiplier les coûts, avec la prise en charge des démissionnaires, sauf à réduire le champ d’application de ces mesures par de savants critères qui les videraient de leur contenu.
Les annexes dits « régimes spéciaux » sont toutes déficitaires alors que le régime général est excédentaire. N’aurait-il donc pas été plus judicieux et plus juste de les intégrer au régime général ?
Ma position serait en effet d’intégrer tout cela dans le régime général… ce dont ne veulent pas entendre parler, par exemple, les intermittents du spectacle, qui, évidemment, n’y trouveraient pas les avantages de leurs annexes.
À une époque où l’universalité des régimes de retraite est posée, la question de l’intégration des annexes du régime de l’Assurance-chômage se pose de facto. On obtiendrait par définition plus d’égalité entre salariés, plus de transparence et plus d’efficience dans l’opérationnalité. C’est une évidence ! Toutefois là n’est pas le problème qui réside bien évidemment dans l’acceptabilité d’une telle réforme par les bénéficiaires eux-mêmes. En d’autres termes, la classe politique, la société française sont-elles prêtes à ce jour à supporter un conflit long qui les priverait d’une bonne partie de ses émissions de télévision, de ses festivals… Rien n’est moins sûr !
Ne craigniez-vous pas que la décision prise par le patronat, toutes organisations confondues, de suspendre sa participation aux négociations sur l’Assurance-chômage signifie la mort du paritarisme ?
Le patronat a effectivement suspendu sa participation aux négociations sur l’Assurance-chômage… pendant quelques jours, avant d’y reprendre sa place. Ce n’est pas qu’il souhaite la mort du paritarisme, même s’il peut être conduit, un jour ou l’autre à prendre acte de cette mort… à la suite des interventions de l’état dans la gestion du régime.
Le régime d’Assurance-chômage souffre d’une faiblesse intrinsèque : sa soumission aux variations de conjoncture économique qui se traduit par des variations considérables de ses ressources et de ses dépenses en très peu de temps. C’est l’effet de ciseaux qui creuse un déficit quand le chômage augmente (hausse du nombre d’indemnisés et baisse du produit des cotisations) et qui inversement fait rentrer plus de recettes que de dépenses en période de croissance (baisse du nombre des indemnisés et augmentation du produit des cotisations).
La garantie de l’État aux emprunts de l’Unédic permet d’assurer le paiement des indemnités de chômage en période de basses eaux. À défaut, l’indemnisation devrait être réduite drastiquement, ce qui est impensable.
La situation est différente d’un régime paritaire à l’autre ; ainsi, l’Agirc-Arrco, en charge des retraites complémentaires, n’a pas la garantie de l’État. Mais si sa gestion est influencée par l’évolution démographique (nombre d’actifs par rapport au nombre de retraités), il s’agit ici d’évolutions lentes, que l’on peut prévoir, à la différence d’une crise conjoncturelle. C’est ainsi qu’à plusieurs reprises, les partenaires sociaux gestionnaires de l’Agirc-Arrco ont pris à l’avance des mesures rigoureuses (désindexation par rapport aux salaires et aux prix, retraite complète à 63 ans, etc…) pour maintenir leur équilibre et donc le paiement des retraites complémentaires, sans que l’État compromette leur gestion.
Si, comme on l’a dit plus haut, l’État a du fait de sa garantie, indispensable, un droit de regard sur la gestion de l’Unédic (et on rappelle que les conventions d’Assurance-chômage doivent être agréées par les pouvoirs publics), cela ne doit pas lui permettre, par des interventions intempestives de vider le paritarisme de sa substance.
Dès lors, il me semble que c’était au moment où la loi, à l’encontre d’un accord signé des partenaires sociaux, a réintroduit dans le régime d’Assurance-chômage, l’ancien système des intermittents du spectacle, que le patronat aurait dû suspendre sa participation aux instances de l’Unédic.
De même, si le gouvernement persiste, en dépit des premiers accords de branche intervenus sur les contrats courts, à vouloir imposer un système aveugle de bonus-malus, absurde dans son principe puisqu’il s’agirait en somme, pour prendre un exemple dans l’assurance maladie, d’augmenter les cotisations des personnes les plus malades dont les soins coutent toujours plus chers à ce dernier régime. Si des corrections sont en effet nécessaires ici et là, la généralisation sans précaution d’un bonus-malus est inacceptable pour les entreprises, qui ne licencient jamais par plaisir, et dont l’horizon n’est pas celui de l’éternité dont bénéficie l’État. Les entreprises sont contraintes de s’adapter rapidement aux variations conjoncturelles de leur activité. Comme l’a très bien dit le Président de l’UIMM, M.Darmayan, dans une interview récente, « ce serait paradoxal de prendre une mesure générale à l’aveugle, pour toutes les entreprises de manière uniforme, alors qu’on vient de faire par ordonnance, une réforme qui prône au contraire la négociation par branche et surtout par entreprise ».
Si, par la loi, le bonus-malus venait à s’imposer sans précaution à l’Unédic, ce serait, après les « recalculés », après le rétablissement du régime des intermittents, une nouvelle atteinte aux principes du paritarisme. On en reviendrait au faux paritarisme de l’assurance maladie, où les partenaires sociaux ne nomment pas le Directeur général (l’exécutif du système), ne fixent pas les cotisations et ne décident pas des niveaux de remboursement. Ils ne donnent que des avis. Cette situation, que l’on peut comprendre dans ce dernier cas, n’est pas acceptable dans les vrais régimes paritaires (Unédic et Agirc-Arrco), là où les partenaires sociaux nomment le Directeur général et fixent les cotisations et les prestations. Si l’État intervient abusivement dans le régime d’Assurance-chômage, ce sera effectivement la mort du paritarisme, et ce ne sont pas les partenaires sociaux, patronat et syndicats, qui en porteront la responsabilité…
Propos recueillis le 11 février 2019